Théorie
2. Un enjeu linguistique: les contacts interlinguistiques
1. Les contacts inter–linguistiques : une réalité universelle
1.1. Pourquoi les langues sont-elles en contact?

Partout dans le monde, les langues sont quotidiennement en contact les unes avec les autres. C’est le contraire qui est inhabituel. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi et comment on peut avoir l’impression qu’une seule langue est associée à un peuple ou à un territoire :
Facteur historique : Historiquement, pour diverses raisons, les autorités politiques ont essayé de séparer les langues en contact, de les garder “pures” sur le plan du vocabulaire et de la grammaire. Cette volonté de séparer des langues était surtout très forte au XIXe siècle, période à laquelle de nombreux intellectuels réfléchissaient au concept de nation. Pour beaucoup d’entre eux, le sentiment national ne pouvait naître, entre autres, que s’il s’appuyait sur une langue partagée et commune à tous les concitoyens et concitoyennes. Mais séparer les langues signifiait bien souvent exclure des langues, des dialectes, des patois; les interdire, les faire disparaître.
Mais l’histoire des langues montre que cet idéal de pureté linguistique, de séparation des langues, est une illusion. Pourquoi? Les langues sont des organismes vivants, dynamiques, mobiles – tout comme les personnes qui les parlent. Elles circulent, se transmettent et évoluent en fonction du réel. Par ailleurs, la langue est un marqueur identitaire fondamental, et les gens résistent lorsque leur langue est menacée.
Facteur militaire : Les conflits militaires pour des conquêtes territoriales et les phénomènes de colonisation ont existé de tout temps, mais ont culminé peu avant la Première Guerre mondiale. Les langues ont été utilisées de tout temps pour imposer la domination et asservir des peuples.

Facteur politique / démographique: Certains gouvernements autoritaires contraignent certaines minorités culturelles et linguistiques à se déplacer au sein du territoire, à quitter leurs terres d’origine. On peut penser par exemple à la population ouïghoure, peuple musulman de langue turque, installé dans la région du Xinjiang en Chine et qui subit les persécutions du gouvernement chinois (plusieurs personnes sont enfermées dans des camps d’internement). On peut aussi penser à la pratique des réserves autochtones qui ont servi à contrôler les populations autochtones en les limitant à ces territoires restreints. Ceux qui n’y résidaient pas perdaient leur statut aux yeux du gouvernement; les femmes qui épousaient un homme en dehors de la réserve perdaient aussi leur statu.
Facteur d’uniformisation linguistique : Les efforts, à la même époque, pour réduire le travail des enfants et augmenter la scolarisation se sont ajoutés à ces idées : des programmes, des manuels scolaires préconisant un certain usage de la grammaire, du vocabulaire ont vu le jour dans différentes langues. Les institutions scolaires, et plus récemment les médias (la radio depuis les années 1930, la télévision depuis les années 1950, internet depuis le début du XXIe siècle et à présent les médias sociaux) constituent de puissants facteurs d’uniformisation linguistique.
Discussion en classe
Pouvez-vous penser à des exemples de langues qui ont été menacées ou qui ont disparu au Canada? Ailleurs dans le monde?
Réfléchissez à chaque fois au contexte : qui menaçait ces langues? Pour quelles raisons? Quel degré de résistance les locuteurs de cette langue ont-ils montré?
Enfin, les langues se contaminent, s’influencent mutuellement.
Malgré ces facteurs et ces efforts politiques, les langues cohabitent sur de mêmes territoires, au sein de mêmes communautés et individus. Il faut également tenir compte du grand brassage linguistique que provoquent les flux migratoires. Il y a toujours eu des déplacements d’individus et de populations à travers l’Histoire, mais le phénomène migratoire constitue aujourd’hui une puissante dynamique linguistique. Comme les personnes qui les parlent, les langues se déplacent, s’hybrident, se transforment. De multiples personnes habitent dans des pays ou des régions autres que là où elles sont nées : pour des raisons familiales, professionnelles, etc. On peut penser aux réfugiés politiques, aux migrants économiques, aux minorités ethniques et culturelles persécutées, etc.
Exemples
Au Québec, les anglophones ont adopté des mots et de structures du français:

“What do you want to take?”
… et inversement, les francophones en situation minoritaire ont recours à de nombreux anglicismes. Pouvez-vous reformuler en “français standard” les énoncés suivants?
“As-tu trouvé ton application pour la position?”
“J’ai pas cherché pour.”
Les enfants étaient sur l’autobus scolaire quand l’accident a eu lieu.
Qui tu vas voter pour?
1.2. Le bilinguisme dans le monde
Les langues sont donc en contact. On estime que plus de la moitié de la population sur Terre est bilingue. Ce comptage demeure très approximatif car les États ne collectent pas tous les données relatives aux langues parlées par leur population; la notion même de “bilinguisme” est très élastique: dans certains pays, être capable de prononcer quelques phrases de base dans une seconde langue suffit à ce que les gens se pensent bilingues. Dans un pays officiellement quadrilingue comme la Suisse, on a une compréhension beaucoup plus fine et exigeante du bilinguisme ou du multilinguisme.
On peut dresser la liste des pays officiellement bilingues dans le monde : Compendium de l’aménagement linguistique au Canada (CALC); il y en a environ 55, répartis à travers tous les continents, ce qui représente environ 28% des pays du monde. Mais le bilinguisme d’état ne nous apprend pas nécessairement beaucoup d’information au sujet de ce que vivent concrètement les gens. Et par-delà les langues officiellement reconnues, il existe de multiples langues locales ou vernaculaires. On estime qu’il existe plus de 7,000 langues dans le monde pour environ 190-200 pays souverains (225-230 territoires). Beaucoup de langues non officielles sont souvent moins véhiculaires, c’est-à-dire qu’elles ne servent pas à véhiculer et à exporter une culture à travers le monde. Ce sont néanmoins des langues à part entière (et non des dialectes), c’est-à-dire qu’elles sont utilisées au quotidien par des groupes entiers.
Pour plus de la moitié des 7 milliards d’êtres humains sur terre, le bilinguisme ou le multilinguisme est une réalité souvent quotidienne, habituelle. Les individus sont habitués à passer d’une langue à l’autre selon les situations, les contextes, leurs interlocuteurs, à l’oral et/ou à l’écrit.
1.3. Des contacts vécus de l’intérieur

Ces contacts inter-linguistiques sont vécus à l’intérieur des individus. Ils impliquent une part de conscience.Certaines personnes utilisent la métaphore de l’interrupteur ou d’un bouton imaginaire en elles pour changer de langue (“brain switch”). Ces contacts entre deux et plusieurs langues au sein du même individu sont parfois harmonieux, parfois fracturés, douloureux. Ils s’opposent aux normes linguistiques, surtout aux normes de la langue écrite.
Pour les minorités francophones du Canada, les contacts entre le français et l’anglais sont constants, tous les jours, presque tous les instants. Le français étant une langue extrêmement normative, notamment en France, ses contacts avec l’anglais créent souvent des frictions.
Pour les immigrants, les contacts entre la langue parlée à la maison et l’anglais sont tout aussi puissants et omniprésents.
La surconscience linguistique, c’est le fait d’être très attentif aux mots qu’on utilise, en essayant de coller à une certaine norme ou à ce qu’on pense être la « bonne façon de parler ».
Exemple :
Quand les étudiants parlent avec leurs enseignants, ils sont plus conscients d’utiliser une langue soutenue, mais avec leurs amis, ils utiliseraient peut-être une langue plus familière.
« Je suis allé » (français standard) vs « Chu allé » (français québécois familier)
L’insécurité linguistique, c’est quand une personne ne se sent pas à l’aise avec sa façon de parler. Elle peut croire que sa manière de s’exprimer n’est pas correcte ou pas aussi bonne que celle des autres.
Exemple :
Un Québécois francophone peut se sentir gêné de parler anglais s’il a un accent fort ou s’il fait des fautes. Il peut avoir peur d’être jugé ou de ne pas être compris, ce qui peut nuire à sa confiance en lui.
Un Franco-Manitobain peut éprouver un certain malaise à s’exprimer en français au Québec si ses interlocuteurs québécois font des remarques sur son accent ou son choix de mots.
1.4. Les contacts interlinguistiques dynamisent les langues
Ces contacts entre les langues les transforment : ils créent du nouveau vocabulaire (chaque année, les dictionnaires acceptent de nouveaux mots, provenant souvent d’autres langues ou adaptés d’autres langues) et à plus long terme, ils créent de nouvelles structures syntaxiques et de nouveaux usages linguistiques.
Exemples

Beaucoup de créativité!
Un pourriel = a spam
POUbelle + couRRIEL
En anglais: To park and load the truck
en franglais: s’parker pis loader l’truck
en spanglish: parkear y loadear el troka
On parle aussi du taglish (Tagalog-English) ou du portuñol (portugais-espagnol).
2. Différents modes de contamination
Nous allons étudier deux processus par lesquels les contacts inter-linguistiques transforment les langues en présence.
2.1. L’alternance codique (ou le changement de code)
L’alternance codique (code-switching) consiste à passer d’une langue à l’autre au sein d’une même conversation, voire d’une même phrase. Dans ce cas, les deux interlocuteurs doivent tous deux maîtriser les mêmes langues. Le changement de code peut concerner un mot ou un segment de phrase ou de discours. Il peut impliquer une forme de jeu, de connivence entre les interlocuteurs et peut refléter leurs compétences linguistiques dans certains domaines (je parle de mon travail dans la langue X; je pratique tel loisir dans la langue Y, alors c’est dans cette langue que j’en parle), ou une certaine paresse (je parle dans la langue X, mais je ne veux pas chercher laborieusement mes mots, alors j’insère les mots de la langue Y qui me viennent spontanément). Souvent, ce type de conversation a lieu entre personnes du même groupe, ou se connaissant bien. Elles savent qu’elles partagent ces langues et que l’autre va entrer dans ce jeu ou utilise aussi ces stratégies. C’est aussi un phénomène qui se vit à la fois au niveau individuel et collectif. Le changement de code peut aussi indiquer une émotion. Je veux exprimer des sentiments douloureux, ou je cherche à réfléchir à une situation complexe, difficile. Je vais formuler ce que je pense, ce que je ressens de façon spontanée, tels que cela me vient en mots dans ma tête.
À court terme, l’alternance de codes ne modifie généralement pas les structures profondes des langues en contact. La grammaire d’une des langues s’impose pour une phrase. Généralement, la prononciation respecte aussi la langue dans laquelle le mot est prononcé. Par contre, à long terme, si la plupart des locuteurs d’une langue minoritaire ont recours au changement de code de façon constante, certaines tournures peuvent se consolider et devenir des réflexes.
Exemple
Les Franco-Ontariens utilisent beaucoup les changements de codes.
Il faut que je fasse changer mon windshield.
Utilise la tab de droite pour ouvrir le folder. C’est easy.
J’étais tellement overwhelmed quand il m’a dit ça. I guess je faisais plus attention à ce qu’il disait après.
2.2. La créolisation
La créolisation est le résultat syncrétique de deux (ou plusieurs) langues en contact qui s’interpénètrent pour former une nouvelle langue, différente et tout aussi complexe, que les langues dont elle est issue. Si cette langue devient stable, elle peut devenir une langue native, autonome pour une région.
On observe que ce phénomène existe surtout dans les îles dont l’isolement et la petite taille géographique permet le développement spontané d’une culture (et d’une langue) de façon assez rapide et homogène.
Par exemple, le créole haïtien est une langue parlée à Haïti, née d’un mélange de langues indigènes et du français apporté par les colons. Cette langue est parlée par plus de 13 millions d’Haïtiens. Les francophones ne peuvent pas la comprendre. C’est une langue à part entière.
Exemples
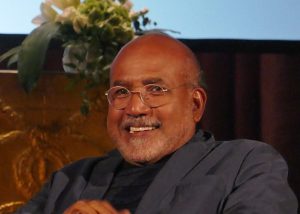
Extrait de Texaco, roman de l’auteur Patrick Chamoiseau, originaire de la Martinique (île des Antilles) .
Observez comment le narrateur reformule spontanément en français la phrase énoncée en créole.
« Mais si les dimanches demeurèrent comme ça dans sa calebasse, ce n’est pièce pas pour cette seule raison. C’est pour bien d’autres choses dont la première se criait Ninon (c’était une femme) et la deuxième : Liberté (c’était je ne sais pas quoi). Dans son temps de vieillesse Liberté et Ninon se mêlèrent si tellement sa tête-mabolo, qu’il s’arrêtait souvent en mitan du chemin, en plein bourg, en pleine messe, en plein sommeil, en pleine blague autour d’un punch, pour hurler Oh tchoué mwen ba mwen libèté mwen, Tchoué mewn mé ba mwen Ninon mwen an, Oh tuez-moi mais laissez-moi la liberté, tuez-moi mais laissez-moi Ninon!… et il fut toujours pas très possible de distinguer de quelle-auquelle des deux il s’inquiétait vraiment.
Référence : Chamoiseau, Patrick, Texaco, Paris, Gallimard, 1992, p. 96-98.
Écoutez un extrait de cette vidéo « Castelline parlant le créole haïtien »
Le métchif ou mitchif est une langue née du Cri et du français parlée par les Métis dans l’Ouest canadien et une partie des États-Unis. Voir quelques explications et exemples
Un exemple directement lié à l’une des région que nous allons étudier : La chanson thème “Let it go”/ « Libérez, délivrez » du film Frozen/La reine des neiges chantée en chiac, langue parlée dans la région de Moncton et résultant du contact à long terme de l’anglais et du français : Écoutez la chanson
J’peux pu holder ça back.
Worry pas, worry pas!
J’care pu quosse qu’i’ pensant.
J’vire de bord, pis j’slam la door.
J’laisse le storm passer…
Le frette m’a jamais botherée anyway!
La créolisation est souvent un phénomène collectif qui peut s’effectuer de façon assez rapide (une ou deux générations) et ensuite se stabiliser. C’est un processus qui induit ainsi un changement durable, une nouvelle réalité.
3. La langue en contexte public, en contexte privé
Nous utilisons différemment les langues en contexte public et en contexte privé. Souvent, une langue est associée à la vie publique, et l’autre à la vie privée. Mais que voulons-nous dire exactement par contexte public et privé?
3.1. En contexte majoritaire
Pour un individu vivant en situation majoritaire, la sphère privée est purement individuelle, même personnelle. Elle peut varier selon les personnes, mais voici quelques exemples généraux :
- Le corps
- L’espace personnel (incluant le téléphone)
- La chambre à coucher
- La salle de bain
- L’automobile
- La table au restaurant
Généralement, l’individu est seul dans ces contextes qui incluent tout au plus son/sa partenaire ou ses proches.
3.2. En contexte minoritaire
Pour une personne en situation minoritaire, la sphère privée est plus diluée, plus expansive : elle est à la fois personnelle et collective. La culture et la langue deviennent une partie de l’espace privé.
D’autres espaces s’ajoutent donc:
- La maison
- L’association communautaire
- Le lieu de culte
- L’école
- La culture (musiques, radio, films, livres, etc.) et la langue elle-même
- Les célébrations culturelles
- La famille étendue
- Les sorties ou soirées entre amis
Bref, tous les lieux, les activités et les gens avec qui cette personne utilise la langue minoritaire.
Exemples:
Imaginez que dans un cours donné dans un grand amphithéâtre, quelques étudiants s’aperçoivent qu’ils parlent tous mandarin et décident de s’asseoir ensemble pour s’entraider et travailler ensemble. Ils créent un petit espace privé qui fonctionne en mandarin au sein de l’espace public de l’amphithéâtre.
Discussion
- Quels domaines de votre vie vivez-vous en français en ce moment? Quels sont les sujets, les champs lexicaux spécifiques que vous développez? Et avec qui?
- Mêmes questions concernant d’autres langues que vous parlez : où les parlez-vous, avec qui, et de quoi parlez-vous dans ces langues?
- Avez-vous déjà vu/entendu des amis, des personnes changer de langue lorsqu’elles s’adressaient à une autre personne?
- Vous êtes-vous déjà trouvé.e en situation de contact interlinguistique? Dans quel(s) contexte(s)? Quelles langues étaient en contact?
4. Le statut et l’évolution des langues minoritaires au Canada
4.1. Loi sur les langues officielles
Le site internet du Commissaire aux langues officielles propose une ligne chronologique détaillée des langues officielles du Canada. Voici les quatre dates récentes les plus importantes:
- 1969 : Adoption de la loi sur les langues officielles, suivant la recommandation de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme
- 1982 : La loi sur les langues officielles est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés
- 1988 : Révision majeure de la loi pour s’assurer qu’elle garantit les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.
La loi précise alors les droits linguistiques des citoyen.ne.s et les obligations linguistiques des institutions fédérales. Elle s’applique à la langue de travail et à la participation équitable des francophones et anglophones à la fonction publique fédérale. Dans la partie VII, le gouvernement fédéral s’engage à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à faire la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne. laws-lois.justice.gc.ca
Citation
Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais
- 41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Engagement — protection et promotion du français
(2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.
Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.
Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
(4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.
Obligation des institutions fédérales — mesures positives
(5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.
- 2023 : Adoption du projet de loi C-13, Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada – une modernisation importante de la loi sur les langues officielles
Un nouveau droit de travailler et d’être servi en français au Québec et dans les régions à forte présence francophone des autres provinces dans les entreprises privées de compétence fédérale (ex. : les banques et les compagnies aériennes ou ferroviaires). Cette loi s’aligne sur les exigences de la Charte de la langue française du Québec. Par cette nouvelle loi, le commissaire aux langues officielles obtient le pouvoir de donner des ordres aux institutions fédérales et crée un régime de sanctions (jusqu’à 25 000 $). Les juges nommés à la Cour suprême doivent être bilingues.
Depuis 1969, le français a ainsi statut de langue officielle au Canada, à part égale avec l’anglais. Ce statut aide à sa protection et à maintenir sa continuité et son dynamisme. Pourtant, bien d’autres langues ne bénéficient pas de la même reconnaissance.
Quelle est la situation actuelle des langues autochtones?
Lisez les deux documents suivants :
Ressource additionnelle en anglais : “Mapping Indigenous languages in Canada”
Discussion en classe
Nous comparerons le français et les langues autochtones (considérées séparément ou par groupes). Voici quelques exemples de questions auxquelles réfléchir :
- Quels sont les écarts entre langue maternelle et langue parlée?
- Quelle est la situation linguistique pour les jeunes de moins de 20 ans?
- Y a-t-il des disparités géographiques : y a-t-il des régions, des provinces où les individus semblent mieux conserver leur langue maternelle?
- Les langues secondes ont-elles un rôle à jouer dans la préservation de certaines langues?
- Comment les langues sont-elles transmises?
- Par-delà la comparaison entre le français et les langues autochtones, pouvez-vous suggérer d’autres comparaisons avec d’autres langues parlées au Canada (pensez aux immigrants de différentes générations, différentes provenances)? La rétention et la transmission des langues non officielles est-elle meilleure? plus difficile?


