À l’ère des nouveaux écrans : la fin du « petit écran » ?
Texte
Préparation
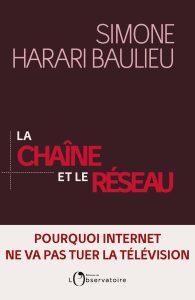
À propos de l’auteure et du texte
Après une longue carrière comme productrice de télévision, Simone Harari Baulieu est bien placée pour analyser le développement actuel de la télé. Dans La Chaîne et le Réseau : Pourquoi Internet ne va pas tuer la télévision, ouvrage publié en 2018, elle se base sur son expérience professionnelle considérable pour expliquer le rapport entre la « télévision » et les nouveaux médias. Comme l’indique le titre du texte à l’étude, elle prédit la survie de la télévision.
Vocabulaire utile
| un écran | a screen |
| un concurrent | a competitor |
| puissant(e) | strong, powerful |
| en moyenne | on average |
| une idée reçue | a common (often false) preconception |
| un foyer | a household |
| s’appuyer sur | to rely / depend on |
| un divertissement | entertainment |
| éveiller des émotions | to arouse emotions |
| en direct | live (context of a broadcast) |
| un téléspectateur / une téléspectatrice | a TV viewer |
| criant(e) | glaring, striking |
| un diffuseur | a broadcaster |
| un atout | an advantage |
| SVOD | Subscription Video On Demand |
| un piège | a trap |
| asservir | to subjugate |
| une boussole | a compass |
| un enjeu | an issue, a challenge |
Questions préliminaires
- Combien d’écrans utilisez-vous chaque jour? Expliquez le contexte et l’emploi de chacun de ces écrans.
- Est-ce que vous regardez la télé? Quel appareil utilisez-vous pour ce faire? Un téléviseur, un ordinateur, une tablette, un téléphone portable?
- Est-ce que vous passez plus de temps à regarder la télé ou sur internet? Est-ce que vous considérez les sites comme YouTube ou Netflix comme une forme de télévision ou quelque chose de différent?
- Est-ce que vous regardez parfois des chaînes de télévision publiques (p. ex. CBC/Radio-Canada, TVO, PBS, France TV, BBC, etc.)? Pourquoi (pas)?
- De nos jours, on entend beaucoup parler des « algorithmes ». Dans quel contexte est-ce que vous entendez ce terme le plus souvent? Savez-vous quels sont les avantages et les désavantages de l’emploi des algorithmes?
Lecture

Dans l’ancien monde, la télé était qualifiée de « petit écran », appellation familière, laissant au cinéma l’appellation majestueuse de « grand écran ». Tout fut bouleversé avec l’apparition phénoménale et si soudaine de l’écran de nos objets mobiles et en particulier de nos smartphones, les « mini-écrans ». Si la télévision « classique » est présente dans 95% des foyers, ces smartphones le sont déjà dans la main de 75% des Français. Ils sont en quelques années seulement devenus l’écran favori, synonyme d’intimité, de lien avec ses amis, de contact avec les autres. Mais sont-ils vraiment les concurrents, voire les remplaçants, du petit écran? Qu’est-ce qui compte le plus : le support ou l’usage ? La technologie de l’équipement ou bien ce qu’on y regarde? La télévision se résume-t-elle à son écran ?
Un compagnon du quotidien
Un premier constat s’impose : la télévision reste puissante. Plus puissante que jamais. D’abord parce qu’elle continue de rythmer nos vies. Sans doute la craint-on et la critique-t-on d’ailleurs pour cela. La télévision, c’est notre troisième activité principale, après le sommeil et le travail. Chaque soir, lors de l’« access prime time », c’est-à-dire entre 18 h 30 et 20 h 45, nous sommes plus de 30 millions de Français et de Françaises à pratiquer la même activité : nous regardons la télévision. En moyenne, en 2017, chaque Français a passé 3 h 42 par jour devant la télé[1] ; ce sont 25 minutes de plus en vingt ans, en progression quasi constante. Et, contrairement aux idées reçues, c’est encore beaucoup plus que le temps passé devant Internet (1 h 23).
La raison de ce succès ? Rappelons l’évidence : depuis son apparition dans les foyers, la télévision s'appuie sur la puissance de l’image. Sa magie même. L’image que l’on associe tout à la fois au divertissement, à la découverte, à la culture. Il n’y a certes plus l’émerveillement des débuts. Sans doute sommes-nous devenus un peu blasés, plus difficiles à surprendre. Mais tout de même, la télé reste un formidable outil pour capter l’attention, transmettre des informations, éveiller des émotions. Soixante-cinq ans ont passé depuis le couronnement d’Elisabeth II, premier événement mondialement suivi en direct par des dizaines de millions de téléspectateurs. Or le 19 mai 2018, plus de 8 millions de Français ont regardé en direct le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Devant notre écran, devant ses images, en 2018 encore, on rêve, on rit, on râle, on pleure, on se souvient, on s’interroge, on s’enthousiasme.
La télévision est toujours, comme on le disait autrefois, « une fenêtre ouverte sur le monde ». Nous avons la possibilité à travers elle de découvrir ce qui nous est extérieur, et parfois même étranger, de nous confronter à l’autre, à des sociétés, des époques, des idées différentes des nôtres. Elle demeure ainsi respectée pour sa capacité à refléter la diversité des vies, des parcours, des envies, des attentes, des personnalités, des opinions. Or, comme l’a très bien montré Dominique Wolton[2], la planète est peut-être devenue considérablement plus petite, mais le monde ne s’est pour autant pas transformé en un gigantesque village. L’espace mondial rêvé cède la place au retour en force des particularismes nationaux, régionaux, voire locaux. Les inégalités sont plus criantes, les divergences culturelles plus visibles et, malgré les progrès foudroyants en matière de mobilité, nous ne pouvons nous soustraire totalement aux contraintes de temps et de distance. Dans ce contexte, la télévision peut s’avérer particulièrement utile pour connaître et, si possible comprendre ce « nouveau » voisin, cet « autre » qui n’a jamais paru aussi proche mais qui, sous bien des aspects, reste si différent et dont parfois nous n’avons jamais eu aussi peur.
Enfin, les progrès technologiques, du côté des fabricants d’équipements comme du côté des producteurs et diffuseurs, en passant par le développement de nouveaux modes de diffusion, n’ont fait que renforcer les atouts de la télévision, qui a su faire preuve d’une incroyable capacité d’adaptation. Lorsque le poste s’est installé dans les foyers, il a fallu lui faire sa place. Une place physique dans le salon familial, ensuite souvent dans les chambres ou la cuisine. Une place dans sa journée aussi, pour ne pas en abuser : d’abord, lors de quelques grands rendez-vous dont la « grand-messe du 20 heures », puis de plus en plus, à toute heure et tous les jours. […]
Pallier les limites de l’algorithme

La logique de l’algorithme est respectable. Elle est même confortable pour le téléspectateur : l’ajustement des offres au goût de chacun se fait optimal. Chaque fan, chaque spécialiste de tel type de musique, de films, d’univers … a la possibilité de se voir immédiatement proposer un programme relevant de son centre d’intérêt, pour son plus grand plaisir.
Mais la conséquence de ce phénomène est évidemment l’enfermement de chacun des publics dans sa bulle, le reflet et l’accentuation des fractures sociales, sociétales et générationnelles. Devant mes réseaux sociaux et mes services de SVOD, je finis par tourner en rond. L’algorithme referme le champ des possibles pour être au plus près de la demande. Me voilà prise au piège d’une « boucle de recommandation » qui ne cesse de me proposer des contenus similaires. Et, lorsque je tente d’échapper à ce filtre et que je regarde à côté, le choix de contenus disponibles est tellement vertigineux que je ne sais plus par quoi commencer. Nous n’avons jamais eu autant de chaînes, autant de plateformes, autant de réseaux, autant de programmes. Mais combien de fois avons-nous eu l’impression de perdre notre temps à rechercher le bon programme, ou même en regardant un programme qui nous était suggéré? Bref, l’aboutissement de l’algorithme semble parfois moins de servir que d’asservir…
Et c’est bien là que l’opportunité de bénéficier d’un service public de l'audiovisuel prend tout son sens. Lui qui, par essence, vocation et mission, doit avoir pour ambition d’accompagner le téléspectateur vers de nouveaux horizons, de l’aider à se faire une opinion, à choisir, dans un environnement où l’offre est devenue pléthorique. Il doit jouer pleinement ce rôle de guide et d’accompagnateur, rassurant et respecté, capable de proposer des programmes de qualité répondant à la diversité des attentes des téléspectateurs. Être une boussole pour leur permettre de se repérer dans la multitude des offres, des désirs et des moments. S’adresser à tous ne se résume pas à la capacité de tout mettre à la disposition de tous. Aucune plateforme conçue et mise en ligne par le service public, aussi innovante soit-elle, ne remplira cette mission de service public si elle se contente de copier les autres plateformes de SVOD disponibles. J’avais vu à ce sujet une certaine ambiguïté dans l’expression « Netflix européen », s’agissant d’un projet public. Si l’ambition est de proposer une plateforme de programmes de services publics favorisant la circulation des émissions et des films en Europe, c’est formidable, mais choisissons peut-être une autre formule pour l’exprimer. Car s’il s’agit de reproduire le système algorithmique avec ses risques et ses impasses, cela me semble être un total contresens ! L’enjeu est bien d’éditorialiser les contenus, de faire le choix d’en promouvoir plus particulièrement certains plutôt que de les mettre tous à égalité, d’aider le spectateur à choisir en éveillant sa curiosité et en l’amenant parfois sur des sentiers qu’il connaît moins (ou qu’il ne connaît pas encore !).
Source : Les extraits sont tirés de La Chaîne et le Réseau : Pourquoi Internet ne va pas tuer la télévision, essai de Simone Harari Baulieu (Éditions de L’observatoire, 2018).
Compréhension
Questions de compréhension et d’analyse
- L’auteure pose une question rhétorique au début du texte : « La télévision se résume-t-elle à son écran ? » Dans ce texte, elle répond que non, la télévision ne se résume pas à son écran. Comment semble-t-elle définir « télévision » ?
- Qu’est-ce que l’auteure essaie d’illustrer en citant le couronnement d’Elisabeth II et le mariage de prince Harry?
- Comment la télévision peut-elle contribuer au rapprochement des gens et des peuples, selon l’auteure?
- De quelle façon est-ce que les algorithmes « enferment » chaque téléspectateur dans sa propre « bulle »?
- Ce texte compare les objectifs et les effets des services SVOD avec ceux des services publics. Quelles sont les grandes différences entre les deux selon la thèse du texte?
Discussion
- Ces statistiques sur la consommation de télévision datent de 2017. Pensez-vous que ces chiffres ont beaucoup changé depuis? Prédisez ces changements et commentez vos prédictions. Ensuite, effectuez une recherche internet pour les vérifier.
- Êtes-vous surpris.e d’apprendre que les Français regardent autant de télévision? Pourquoi (pas)?
- L’auteure pense que le succès de la télé s’explique en grande partie par « la puissance de l’image. » De quelles façons est-ce que les nouveaux médias profitent aussi de cette puissance, voire « magie » ?
- Dans votre expérience, les différentes générations ont-elles une relation particulière à la télé? Expliquez.
- En considérant les arguments présentés par ce texte et encore d’autres facteurs, pensez-vous qu’il vaut la peine de financer les services publics de l’audiovisuel?
a screen
3e personne du singulier du verbe « être » au passé simple
competitors
an observation
strong, powerful
on average
a common (often false) preconception
a self-evident fact
households
s’appuyer sur = to rely/depend on
entertainment
awe, amazement
jaded, bored
to arouse emotions
live (context of a broadcast)
TV viewers
râler - to grumble
unknown
demeurer = to remain
for all that ; nevertheless
glaring, striking
sudden, blistering
se soutraire à = to escape, to avoid
broadcasters
advantages
le poste (de télé) = a TV set
a bubble
l'acronyme de "Subscription Video On Demand", qui signifie en français "vidéo à la demande par abonnement"
a trap
a loop
to escape
staggering
outcome
to subjugate
public broadcasting service
overabundant
a compass
impasses; deadlocks
nonsense; insanity
an issue; what’s at stake

